Entre l’illusion de l’achèvement et l’inéluctabilité du dépassement : Lecture critique de la dynamique de gestion et d’innovation institutionnelle et administrative
Dr. Chanfar Abdellah
Premièrement : le contexte général de la problématique
La question de la gestion, de l’administration et de l’innovation dans les institutions publiques demeure l’une des plus pressantes dans la pensée organisationnelle et managériale contemporaine.
Il arrive parfois que de petits détails révèlent de profondes failles dans la vision administrative.
Dans un pays dont les systèmes ont cru au développement, à l’innovation et à la nécessité du dépassement ; lors d’une visite inopinée d’une institution publique réputée pour sa discipline, sa qualité et l’excellence de ses services, son président présenta un exposé soigné sur le bilan des performances et sur la manière de gérer et d’administrer le service public.
L’exposé fut très convaincant, riche en chiffres et en résultats, couronné par l’admiration et la confiance des visiteurs. L’institution semblait avoir atteint l’apogée de son excellence, ne laissant plus de place qu’aux applaudissements.
Or, le moment décisif ne résida pas dans l’exposé lui-même, mais dans la simple question posée par le haut responsable gouvernemental à la fin de la visite : « Quels sont les horizons et les programmes futurs de l’institution pour les cinq prochaines années ? » Une question directe et logique, mais qui ouvrit une brèche plus profonde.
Le président, encore grisé par la fierté et la célébration des acquis, répondit : « Monsieur, nous avons atteint le sommet de la réalisation, nous n’avons plus rien à ajouter désormais. »
Un silence pesa alors. Le responsable cacha son étonnement, retint son commentaire et quitta les lieux sans réaction. Mais dès le lendemain, la décision tomba : révocation du président, assortie d’un message de remerciement et de courtoisie pour ses services rendus.
Les employés s’interrogèrent, certains dénoncèrent vivement la décision, la considérant comme une ingratitude face aux accomplissements. Pourtant, la lecture plus profonde ne résidait ni dans le remerciement ni dans la révocation, mais dans ce qu’ils signifiaient : une direction qui considère le sommet comme une fin perd toute légitimité. La gestion n’est pas une station terminale, mais un processus, un devenir, un horizon imposant le dépassement continu et durable.
La décision n’était ni vengeance, ni déni, ni ingratitude ; elle signalait que l’immobilisme et la stagnation représentent un danger plus grand que l’échec, et que l’institution qui s’arrête aux limites de ses réalisations, aussi grandes soient-elles, entame son déclin.
La gestion et l’administration sont, dans leur essence, un mouvement perpétuel vers l’avenir, misant sur l’anticipation, le positionnement, la création, l’innovation et la prospection des risques comme des opportunités, plutôt que sur la complaisance dans le passé.
Ainsi, tandis que les institutions s’efforcent de consolider leurs acquis et d’améliorer leurs services, la problématique fondamentale demeure : comment dépasser le moment de la réussite pour ouvrir de nouveaux horizons d’innovation et de développement ?
Ce travail de recherche part d’un cas réel et symbolique : une visite officielle dans une institution prospère se transforma en moment révélateur des limites de la vision future de son dirigeant, ce qui entraîna sa révocation malgré la qualité des réalisations accomplies.
Dès lors, des questions dialectiques surgissent : une gestion peut-elle prétendre à l’achèvement ? Le succès se mesure-t-il au passé ou à la capacité de projection dans l’avenir ?
La problématique fondamentale réside dans la tension permanente entre la satisfaction des réalisations passées et la capacité de dépassement continu.
D’un côté, les institutions publiques doivent valoriser leurs acquis et leurs accumulations ;
De l’autre, s’en contenter peut devenir un piège mortel qui ruine la dynamique de création et d’innovation.
À partir de là, plusieurs questions secondaires se posent :
Une institution performante peut-elle proclamer son achèvement dans un monde régi par des mutations rapides et incessantes ? Une direction administrative a-t-elle le droit de considérer le sommet de la réussite comme une fin et non comme le commencement d’un nouveau cycle ?
Ce qui sembla être un simple incident lors d’une visite officielle dans une institution publique de grande réputation s’avéra un révélateur des profonds dilemmes de la gestion publique : les limites de la vision et la dialectique entre la continuité, l’innovation et l’ouverture d’horizons.
La déclaration du président — affirmant avoir atteint le sommet — n’était pas un simple propos, mais le signe d’une conception réductrice de la gestion, enfermée dans l’instantané et fermant toute perspective d’avenir.
Deuxièmement : la gestion comme processus et non comme finalité
Que signifie réduire la gestion à une mesure ponctuelle de réussite ? Une institution publique peut-elle s’arrêter à une étape donnée dans un processus qui ne connaît pas de fin ?
L’histoire de la pensée managériale montre que les organisations qui prétendent à l’achèvement tombent vite dans le piège de la stagnation. La réalisation, aussi grande soit-elle, ne prend sens que si elle s’ouvre à la perspective du dépassement. La gestion doit être envisagée comme un processus ouvert, dont la dynamique repose sur l’anticipation, l’adaptation et le renouvellement. Toute prétention à l’achèvement n’est rien d’autre qu’une annonce implicite du déclin.
Troisièmement : l’innovation entre durabilité et illusion
L’innovation possède-t-elle des limites temporelles ou un sommet ultime ? Comment distinguer l’innovation comme dynamique continue de l’innovation comme événement ponctuel épuisé avec le temps ?
Parler d’un sommet atteint révèle une incompréhension de la nature même de l’innovation institutionnelle. L’innovation n’est pas un événement clos, mais un état d’esprit et une organisation en mouvement permanent. Toute institution, quelle que soit l’excellence de ses services, risque de devenir inerte si elle n’investit pas dans une dynamique de création renouvelée. L’innovation durable devient alors une condition existentielle et non une option accessoire.
Quatrièmement : le leadership entre consolidation et dépassement
Le leadership se limite-t-il à la préservation des acquis, ou son essence réside-t-elle dans la capacité à ouvrir de nouveaux horizons dépassant le présent ?
La révocation du président n’était pas une sanction, mais un message clair : le leadership public ne se mesure pas à la capacité de maintenir l’existant, mais à celle de projeter ce qui n’existe pas encore. Le dirigeant qui sacralise le passé perd la capacité de réinventer l’institution. Ainsi apparaît la paradoxale vérité : le succès, s’il ne devient pas une plateforme de renouvellement, se transforme en obstacle à l’évolution.
Cinquièmement : la prospective comme condition existentielle de la gestion
Jusqu’où les institutions publiques peuvent-elles concevoir leur avenir en échappant à l’illusion de l’achèvement ? La prospective est-elle un luxe intellectuel ou une nécessité stratégique de survie ?
Dans un environnement marqué par des mutations rapides, la prospective est une exigence existentielle. Il ne suffit pas que l’institution remplisse ses fonctions actuelles avec efficacité ; elle doit anticiper les risques, devancer les défis et réinventer ses rôles de manière continue. L’absence de vision prospective équivaut à l’absence de capacité de survie.
Sixièmement : vers une redéfinition du succès institutionnel
Peut-on redéfinir le succès en dehors de la logique d’un acquis figé, pour en faire un processus perpétuellement inachevé ?
Le succès, à la lumière de l’expérience étudiée, ne réside pas seulement dans ce qui a été accompli, mais dans ce qui peut encore être réalisé. Les institutions qui considèrent le sommet comme une fin trahissent l’esprit de la gestion, qui est par nature un projet inachevé. D’où la nécessité de repenser la notion même de succès : non comme un résultat chiffré, mais comme une ambition permanente de dépassement de soi.
Conclusions générales : la gestion comme horizon sans fin
Si le passé atteste d’une réalisation, l’avenir reste une épreuve permanente pour la volonté institutionnelle. La leçon la plus profonde est que la gestion ne connaît pas de fin ; chaque sommet atteint n’est que le début d’un nouveau chemin.
Peut-on alors concevoir un modèle de leadership qui reconnaisse que le succès ne se complète jamais ? Peut-on construire une culture organisationnelle qui considère l’immobilisme comme un danger plus grand que l’échec ?
Ces questions demeurent ouvertes, car l’action managériale — en tant que lutte permanente contre la stagnation et l’inertie — n’offre jamais de réponse définitive, mais reste tendue vers l’horizon de la prospective et du positionnement, où risques, opportunités et possibles se renouvellent sans cesse.






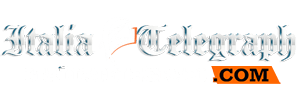

 English
English Español
Español Deutsch
Deutsch Français
Français العربية
العربية