Critiquer n’est pas caricaturer : pour une lecture rigoureuse du religieux au Maroc (6/6)
Par Dr Mohammed Berraou, expert international en gouvernance et auteur du livre : la bonne gouvernance à la lumière des orientations royales
Sixième réponse au sixième et dernier épisode de la série du journal le monde : « l’Enigme Mohamed VI »
Le 29 août 2025, Le Monde publiait le sixième et dernier volet de sa série « L’énigme Mohammed VI », consacré au rapport entre le souverain marocain, l’islam et les mouvements islamistes. Le sujet est majeur : comprendre le rôle du roi en tant que commandeur des croyants éclaire non seulement l’architecture politique marocaine, mais aussi les dynamiques d’autorité, de réforme et de légitimité dans un contexte post-Printemps arabe.
Mais la pertinence du thème ne suffit pas à garantir la qualité du traitement journalistique. Car dans ce dernier épisode, Le Monde semble délaisser les exigences d’une méthode rigoureuse au profit d’une narration chargée d’interprétations symboliques, d’approximations contextuelles et de biais culturels récurrents. Il s’agit ici non pas de récuser le droit légitime à la critique, mais d’exiger qu’elle respecte les principes professionnels que Le Monde applique, à juste titre, à d’autres États.
Une vision symboliste qui occulte les institutions
L’article s’ouvre sur un contraste : le roi recommande à ses sujets de renoncer au sacrifice de l’Aïd al-Adha, puis sacrifie deux béliers en public. Pour Le Monde, ce geste révèle une mécanique du pouvoir entre tradition, autorité et spectacle. Mais cette lecture hyper-symbolique s’autorise beaucoup sans démontrer grand-chose.
La fonction religieuse du roi ne peut être réduite à une scène rituelle, fût-elle filmée. Elle s’inscrit dans un système institutionnel structuré : Conseil supérieur des oulémas, Institut Mohammed VI pour la formation des imams, Fondation des oulémas africains. Autant d’organes créés pour encadrer le champ religieux, garantir son indépendance vis-à-vis des radicalismes et articuler tradition malékite, modernité politique et soft power africain.
En ignorant ce cadre, Le Monde substitue à l’analyse factuelle une approche esthétique : les gestes remplacent les textes, les images font office d’arguments. Cela affaiblit la portée explicative de l’article.
Un récit occidentalo-centré du religieux
Autre limite méthodologique : le traitement du religieux comme résidu d’un pouvoir figé, opaque, voire archaïque. L’article suggère que la sacralité du roi permettrait d’éluder les exigences constitutionnelles, de contourner le jeu partisan, voire de neutraliser la pluralité. Ce type de raisonnement repose sur une conception sécularisée et linéaire de l’évolution politique, où toute articulation entre religion et pouvoir est suspecte par nature.
Or, le cas marocain relève d’un modèle hybride : la monarchie incarne à la fois la continuité historique et la réforme institutionnelle. La Constitution de 2011 ne supprime pas la sacralité, mais l’inscrit dans un cadre juridique clair, aux côtés de libertés fondamentales, d’un parlement élu et d’un gouvernement issu des urnes. Nier cette cohabitation, c’est reconduire une lecture hiérarchisée du monde, où les trajectoires politiques ne vaudraient que si elles épousent le schéma eurocentrique de la sécularisation.
L’islamisme, un acteur politique vidé de sa complexité
Sur le terrain de l’islam politique, Le Monde évoque une « guerre d’usure » du palais contre le Parti de la justice et du développement (PJD), arrivé en tête des élections en 2011 puis marginalisé en 2021. Il y aurait, selon l’article, une stratégie consciente de délégation des mesures impopulaires, de neutralisation par la cooptation, et d’éviction progressive.
Mais cette lecture ignore deux faits fondamentaux : d’une part, les dynamiques internes au PJD, marqué par des tensions idéologiques, une perte de crédibilité électorale et des compromis ambigus ; d’autre part, l’alternance démocratique réelle à l’œuvre, avec des transitions pacifiques et une participation pluraliste. Réduire ce processus à un plan d’usure calculé, c’est mépriser l’intelligence politique des électeurs marocains, et oublier les limites structurelles propres aux partis islamistes dans la gestion du pouvoir.
Des libertés bornées, mais un débat en cours
Le Monde souligne, à juste titre, les limites qui subsistent en matière de libertés individuelles et de conscience. La question de l’héritage, notamment, reste un verrou doctrinal. Mais là encore, le traitement manque de perspective : aucune mention n’est faite des débats parlementaires, des prises de position de la société civile, ni de la révision de la Moudawana engagée en 2023.
Il ne s’agit pas de nier les blocages, ni de maquiller les tensions. Il s’agit d’observer que le Maroc vit un processus de réforme endogène, à son rythme, selon ses propres équilibres – où le religieux n’est pas nécessairement un obstacle, mais souvent un cadre de négociation. Réformer l’islam familial ou cultuel depuis une monarchie de droit divin est un défi complexe, mais c’est un défi assumé publiquement par le roi lui-même.
Pour une critique journalistique à hauteur de sujet
Le Maroc est un pays en transformation. Son système n’est ni un modèle achevé ni un régime figé. Il avance entre contraintes et ambitions, inerties et volontés, traditions et ajustements. Ce qui appelle une critique journalistique exigeante, mais aussi nuancée, informée, et sensible aux logiques internes.
La critique est un droit. La caricature est une facilité. Quand Le Monde remplace l’analyse par le symbole, le contexte par l’image, et la pluralité par la projection, il ne rend pas service à ses lecteurs. Ni au journalisme. Ni au Maroc.
À l’heure où les récits du Sud sont souvent racontés depuis le Nord, il est temps d’inverser la focale, ou à tout le moins, de corriger la lentille. Une observation lucide n’est pas une fiction bien racontée. C’est une enquête appuyée sur les faits, la pluralité des voix, et les réalités – même lorsqu’elles déconcertent les cadres d’analyse habituels.






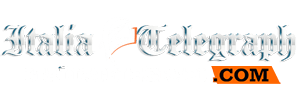

 English
English Español
Español Deutsch
Deutsch Français
Français العربية
العربية