Pouvoir, soupçons et silence systématique : Ce que Le Monde ne dit pas sur le Maroc (5/6)
Par Dr Mohamed Berraou expert international en gouvernance et auteur du livre : « la bonne gouvernance à la lumière des orientations royales »
Cinquième réponse correspondant à l’épisode 5 sur 6 de la série du journal le monde :
« L’énigme Mohammed VI »
Secrets de palais ou stratégie de soupçon ?
Dans son cinquième épisode sur six de la série « L’énigme Mohammed VI », publié le 28 août 2025, Le Monde prétend lever le voile sur les coulisses du pouvoir marocain sous le titre évocateur : « Mohammed VI, le makhzen et l’art des secrets de palais ». À première vue, le lecteur s’attend à une plongée fine dans les dynamiques institutionnelles du royaume. Mais très vite, le registre bascule : le Maroc y apparaît comme un système opaque, fondé sur les humeurs royales, les signes protocolaires, les luttes internes et les loyautés personnelles.
Le pouvoir devient ici un jeu d’apparences, de présences et d’absences. La disparition de Yassine Mansouri, patron du renseignement extérieur, lors de la prière de l’Aïd à Tétouan, est interprétée comme un indice de disgrâce. La non-invitation d’Othman Benjelloun à un événement officiel en 2012 devient une sanction symbolique. Chaque geste est un code, chaque absence un message, chaque nomination une intrigue.
Mais ce que Le Monde présente comme une enquête est en réalité une lecture codée à sens unique, où le doute tient lieu de démonstration, et où la complexité institutionnelle du pays disparaît derrière un récit de type quasi-novelesque.
Une lecture enfermée dans le prisme du soupçon
Le récit proposé dans l’épisode 5 sur 6 réduit les institutions marocaines à des accessoires autour d’un monarque omnipotent. Il ne fait jamais mention de la réforme constitutionnelle de 2011, ni du rôle du Parlement, ni des mécanismes de responsabilisation du gouvernement, ni même des multiples formes de médiation politique ou sociale existantes.
À la place, l’article nous présente une cour monarchique, dominée par un noyau restreint de figures connues : Fouad El Himma (« le vice-roi »), Mounir Majidi (gestionnaire de fortune), Yassine Mansouri (renseignement extérieur), et Abdellatif Hammouchi (sécurité intérieure). Le tout orchestré autour du roi, présenté tantôt comme un arbitre silencieux, tantôt comme un chef de clan, entouré d’un “club des sept” technocrates, anciens camarades du Collège royal.
Mais cette focalisation sur les individus, sans mise en contexte institutionnel ni regard systémique, transforme l’analyse en théâtre d’ombres, où tout devient interprétation et où rien ne se lit autrement qu’à travers une méfiance permanente envers l’État.
Où sont passées les réformes ?
Dans sa volonté de démontrer que le pouvoir marocain repose uniquement sur le contrôle personnel et les relations informelles, Le Monde évacue purement et simplement les réformes structurelles du règne.
Pas un mot sur la nouvelle Constitution adoptée à la suite du Printemps arabe. Rien sur les avancées économiques majeures comme le développement de Tanger Med, la transition énergétique, ou la généralisation de la couverture médicale. Aucun rappel sur la régionalisation avancée ou sur les politiques d’inclusion territoriale.
Au lieu de cela, l’article évoque ces projets à demi-mot, pour mieux les réduire à des instruments de séduction externe ou de légitimation interne. Le TGV devient un gadget. La montée en puissance du Maroc en Afrique n’est qu’une stratégie d’image. Le développement devient suspect par nature.
Cette lecture fait l’erreur méthodologique majeure de croire que l’imperfection invalide la sincérité. Or toute réforme dans un pays comme le Maroc, traversé par une pluralité de cultures, d’identités et de mémoires, est nécessairement graduelle, adaptative et parfois heurtée. Cela n’enlève rien à leur réalité ni à leur portée.
Une monarchie sans légitimité institutionnelle ?
L’article de Le Monde peine à saisir la nature hybride et singulière de la monarchie marocaine. Il oppose modernité et tradition, personnalisation et réforme, comme s’il s’agissait de contradictions insolubles. En réalité, la monarchie au Maroc n’est pas une anomalie, mais l’épine dorsale d’un système de régulation politique, qui assume à la fois un rôle historique, religieux, symbolique et institutionnel.
Le roi n’est ni un simple président, ni un monarque d’apparat. Il est, selon la Constitution, garant de l’unité nationale, de la continuité de l’État, et de l’équilibre entre les pouvoirs. Ignorer cela, comme le fait Le Monde, revient à nier le pacte politico-social marocain dans son essence même.
Les clans, la famille, le soupçon : une vision de cour et non d’État
Le Monde consacre de longs paragraphes à évoquer les tensions entre les figures du pouvoir : rivalité entre la DST et la DGED, mise en avant ou en retrait de certains conseillers, tensions supposées avec les sœurs du roi, prudence autour du prince héritier, ou retour inattendu de la princesse Lalla Salma. Là encore, la stratégie est claire : faire primer l’informel sur le formel, le familial sur l’institutionnel.
Mais que reste-t-il du fonctionnement réel de l’État marocain ? Du rôle du gouvernement ? Des intermédiaires sociaux ? Du pluralisme partisan, même encadré ? Rien. Tout est ramené à une guerre de réseaux et à une lecture freudienne du pouvoir.
Ce regard de type palatial nie l’existence d’un État structuré, et renforce l’image d’un système en permanence gouverné par les coulisses. C’est une vision romancée, mais profondément réductrice.
Un modèle unique imposé : occultation de la souveraineté marocaine
Enfin, Le Monde juge le Maroc sans jamais questionner son propre référentiel. Le pays est évalué selon les critères d’une démocratie libérale occidentale, sans que les particularités culturelles, historiques, religieuses ou géopolitiques du royaume ne soient prises en compte.
Or, le Maroc n’est pas une copie ratée de Westminster ou de la Cinquième République. Il forge son propre modèle politique, articulant tradition monarchique, modernisation économique, dialogue social et stabilité régionale. Ce modèle n’est pas parfait, mais il est souverain, légitime, et largement soutenu par une société qui connaît ses repères.
Vouloir imposer un modèle unique, c’est nier l’autonomie intellectuelle et politique du Sud global, au nom d’un universalisme qui, trop souvent, oublie d’écouter avant de juger.
En guise de conclusion : la simplification au détriment du sérieux ?
L’article de Le Monde ne manque pas d’intelligence stylistique, ni d’informations. Mais il lui manque l’essentiel : la rigueur méthodologique, la profondeur contextuelle, et le respect de la complexité politique et sociale marocaine.
En prétendant dévoiler des secrets de palais, il finit par masquer les vraies dynamiques du Maroc contemporain. Et ce faisant, il rate ce qui fait la singularité du royaume : un pays en transition, certes imparfait, parfois lent, mais fondamentalement maître de son destin.






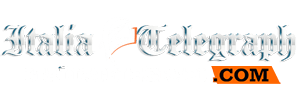

 English
English Español
Español Deutsch
Deutsch Français
Français العربية
العربية