Un article du critique irakien Mueyyed Aloui
Lorsque j’ai terminé sa lecture, je l’ai appelé depuis l’Irak, où je vis, pour parler avec Yassine, le romancier qui vit en france à Nice. Ma question était : les événements sont-ils réels et quelle est la part d’imaginaire littéraire ? Il m’a répondu que l’imaginaire littéraire ne représentait que 2 %. Puis il m’a demandé : « Es-tu choqué par les événements ? » J’ai répondu : « Oui, profondément choqué par ce que j’ai lu ! ».
Je fais ici référence à ma question, posée à l’écrivain tunisien Yassine à travers un réseau social, concernant son texte. J’avais entendu auparavant – et j’en ai eu confirmation par le Dr Saïd Adnane, à qui je suis très reconnaissant – que le critique Dr Ali Jawad Al-Taher avait pour habitude de questionner le nouvelliste sur son récit et le poète sur sa poésie, autant qu’il le pouvait, avant d’écrire sur leurs œuvres.
Quant au roman Le Temps de la fatigue chronique, il est techniquement accompli à tous les niveaux, aussi bien sur le plan artistique que thématique. Pour reprendre les mots du Dr Inad Ghazouane, les aspects techniques vont de l’usage de la première personne, aux manœuvres narratives, en passant par les dialogues entre personnages, ainsi que la maîtrise des outils du roman : le lieu (la banque, entre autres), le jeu du temps resté linéaire et monotone pour correspondre à la vérité du réel, et des personnages dont les gestes, les émotions et les pensées sont dessinés plutôt qu’écrits, tant la description est précise et vivante.
Le grand écrivain tunisien Yassine a su manier ses techniques littéraires avec brio, soulignant que le protagoniste n’a pas de nom : les événements se déroulent autour de lui sans qu’il soit jamais nommé. Puisque le roman est réaliste à 98 %, relatant des événements réels, et que le héros est une victime du capitalisme américain après la chute du régime tunisien en 2011, l’absence de nom souligne le caractère universel de cette oppression, répétée partout où l’influence américaine et ses alliés apparaissent dans le récit. Des auteurs et critiques d’Irak, arabie saoudite, et de Syrie ont déjà écrit sur ce roman, mais aucun de Tunisie, ce qui confère à l’œuvre une authenticité et une crédibilité accrues, puisqu’elle touche un point sensible du tissu culturel tunisien.
N’est-il pas étrange qu’aujourd’hui, 4 romans d’un jeune écrivain tunisien nommé Yassine Loghmari soient publiés, sans qu’aucun critique ou écrivain tunisien n’en parle ? Que devait-il faire pour mériter autant de silence ? Les événements du roman tournent autour d’un jeune employé de banque tunisien dirigée par un « baron » ayant des relations capitalistes avec l’Amérique et, après 2011, avec le parti islamiste Ennahdha. Ce « baron » collabore aussi avec le gendre de l’ex-président déchu et ne cherche que le profit, au détriment des citoyens tunisiens.
Le jeune héros Yassine Loghmari, lui, plaide pour l’aide aux gens, la réduction des profits et la justice climatique, sociale et financière. C’est ce qui pousse certains écrivains et une professeure d’université à le menacer de l’envoyer en Syrie pour le faire tuer, comme cela s’est produit après 2011 avec certains jeunes Tunisiens. Dans le roman, Yassine Loghmari écrit :
« Une écrivaine et professeure d’université tunisienne a envoyé mes romans à une autorité politique obscure, les incitant à me persécuter sous prétexte que mes penchants littéraires contredisaient mes orientations académiques, et que mes œuvres appelaient à la justice sociale, climatique et financière. Elle a même appelé à m’exiler en Syrie, comme on le faisait après la révolution avec certains jeunes qui avaient montré une conscience élevée et des talents en dehors de leurs spécialités, afin qu’ils soient éliminés ensuite, tout en rejetant la faute ailleurs au jihad… »
La guerre contre le jeune homme s’enflamme de tous côtés dans sa vie… Pourtant, le héros poursuit son master en analyse financière avec détermination, malgré cette guerre féroce menée par la banque et ses complices. Quand il essaie de publier son roman, le milieu culturel le rejette, allant jusqu’à l’accuser de folie et de tentative de suicide. Mais il continue d’espérer la victoire, persuadé d’être dans son droit et que ses adversaires sont dans l’erreur.
Le titre Le Temps de la fatigue chronique – récit autobiographique – explique pourquoi j’ai demandé à l’auteur le degré de réalisme et d’imaginaire dans son œuvre. L’ouverture du roman, rappelant la mention « récit autobiographique », commence par cette citation : « Toi qui entres ici, abandonne tout espoir / Dante ». L’écrivain vise la banque où il a travaillé, ce lieu où le pouvoir de l’argent et de la politique lui a causé tant de malheurs, à travers la voix du héros sans nom.
Il établit un parallèle entre sa vie et celle du protagoniste, montrant comment l’argent et le pouvoir gangrènent la plupart des intellectuels tunisiens, sauf quelques rares exceptions. Viennent ensuite deux autres citations :
– « Tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer soi-même / Tolstoï », qui s’applique aux universitaires et aux calomniateurs du héros ;
– « La première valeur dans la réussite de tout projet économique, c’est l’homme. L’économie ne consiste pas seulement à bâtir une banque ou une usine, mais à construire l’homme et à mobiliser les énergies sociales au service d’un projet animé par une volonté de civilisation / Malek Bennabi », qui dénonce l’américanisation du monde par le capitalisme et la mondialisation néolibérale.
Le roman se clôt sur une défense par la romancière algérienne mondiale Ahlem Mosteghanemi, ex-ambassadrice de l’UNESCO pour la paix, affirmant son droit d’écrire, même s’il n’est qu’un jeune homme…






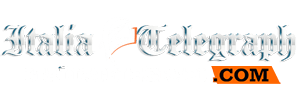

 English
English Español
Español Deutsch
Deutsch Français
Français العربية
العربية