De l’instruction orale à l’instruction écrite dans l’acte administratif marocain: Mettre en question le pouvoir et construire un État de droit par la loi
• Dr. Abdellah CHANFAR
Dans l’État moderne, le pouvoir ne se pratique pas dans l’ombre, mais au grand jour, sous le regard de la loi, à travers des documents et non des caprices. Pourtant, une large part de la pratique administrative marocaine demeure soumise à une autorité invisible : celle des instructions orales. Des ordres sont transmis sans laisser de trace écrite, exécutés sans fondement documenté, et, lorsque survient le moment de rendre des comptes, chacun se défausse… sauf le plus faible.
Cette réalité soulève des problématiques fondamentales : Peut-on construire un État de droit alors que son administration continue de fonctionner à l’oral ? Qui protège l’agent public contre les “instructions non écrites” ? Pourquoi le pouvoir marocain craint-il la documentation? Vivons-nous dans une culture qui privilégie l’allégeance au texte, la soumission à la responsabilité?
Nous tenterons dans cet article d’interroger cette problématique de manière structurelle, analytique et dialectique, en analysant ses dimensions et manifestations dans l’acte administratif marocain, et en proposant des pistes de sortie du silence complice vers un horizon de transparence fondée sur le droit.
1. L’oralité comme mécanisme de dissimulation du pouvoir
L’administration marocaine, malgré les nombreuses réformes législatives, conserve encore une logique de “l’oral d’abord”, notamment lorsqu’il s’agit de décisions sensibles ou potentiellement irrégulières.
Pourquoi cette préférence pour l’oralité chez certains responsables ? La réponse est claire : l’absence de trace. Lorsqu’un supérieur donne un ordre oral, il se libère de toute obligation juridique. Si les choses tournent mal, il interroge froidement son subordonné : « Qui vous a écrit de faire cela ? »
Cela nous ramène à une interrogation structurelle : l’administration fonctionne-t-elle selon le droit ou selon une logique d’évitement du droit ? Lorsque l’oral supplante l’écrit, le pouvoir bascule d’un système de responsabilité vers un réseau d’opacité, de l’obligation de rendre compte vers l’impunité.
2. L’agent public comme victime : de l’exécutant au bouc émissaire
Dans tout système dominé par l’oralité, l’agent de rang intermédiaire ou inférieur est la première victime. On lui demande d’exécuter des instructions souvent contraires à la légalité, sans lui fournir aucun document pouvant l’en protéger. Et lorsque survient un conflit ou une crise, il se retrouve seul face à des institutions qui lui demandent : « Où est la preuve ? »
Faut-il alors blâmer l’agent pour n’avoir pas exigé une trace écrite, ou condamner un système qui ne produit pas de document en premier lieu ?
Ce que nous vivons dans l’administration marocaine est une contradiction choquante : l’agent est tenu responsable de l’exécution d’un ordre, tandis que celui qui l’a donné ne peut être inquiété puisqu’il ne l’a pas rédigé.
3. L’État comme entité orale : quand l’institution s’efface au profit de l’individu
Les instructions orales ne sont pas de simples outils pratiques ; elles révèlent un indicateur culturel profond. Elles traduisent la fragilité de la dimension institutionnelle de l’État et la prééminence du “personnalisme” sur la normativité juridique.
Dans de nombreux secteurs publics, la règle n’est pas ce que dit la loi écrite, mais ce que le responsable interprète, dirige par téléphone ou à travers les coulisses.
Sommes-nous donc face à une administration juridique ou à une chefferie bureaucratique ?
Un État de droit ne se construit pas à coups d’instructions orales, mais à travers des décisions encadrées, traçables, révisables et soumises à reddition de comptes.
4. Entre exception légitime et dérive systématique : l’oralité comme nécessité temporaire, non comme règle générale
Malgré les critiques fondamentales adressées aux instructions orales, une analyse honnête, juridique et administrative exige de reconnaître certaines situations exceptionnelles justifiant un recours temporaire à l’oralité : urgence, péril imminent, force majeure — lorsque l’écrit est impraticable sans compromettre le service public ou mettre en danger les citoyens.
Le problème ne réside donc pas dans l’exception légitime, mais dans sa transformation en prétexte permanent, utilisé pour échapper à toute responsabilité et vider le principe de documentation administrative de sa substance.
Comment alors garantir que l’oralité reste dans ses bornes exceptionnelles, justifiées et encadrées, sans devenir un mode de gestion parallèle ?
La réponse réside dans la mise en place de mécanismes rationnels de régulation de la décision administrative, notamment :
1. L’obligation pour tout responsable de rédiger un complément écrit a posteriori en cas d’instruction orale urgente, précisant le contexte et le contenu de l’ordre donné.
2. Le droit pour l’agent d’exiger une confirmation écrite, sans que cela soit considéré comme un acte d’insubordination.
3. L’introduction dans le droit administratif d’une liste limitative de situations autorisant temporairement l’oralité, en en définissant clairement les effets et la durée.
Par cette approche, on protège l’administration contre l’immobilisme formel tout en la prémunissant contre les dérives orales. L’État de droit admet la flexibilité, mais ne saurait en faire un vecteur de désordre.
5. Vers une culture administrative légale : passer de l’obéissance à la conformité
La différence entre un agent dans un système traditionnel et un agent dans un État de droit est la suivante :
1. Dans le système traditionnel, on exige de lui une loyauté et une obéissance aveugles.
2. Dans l’État moderne, on exige sa conformité au droit, non sa soumission à l’individu.
Mais l’agent public marocain est-il préparé, culturellement et psychologiquement, à penser ainsi? La formation administrative l’amène-t-elle à questionner la base juridique d’un ordre avant de l’exécuter, ou bien la culture du « exécute d’abord, discute ensuite » continue-t-elle de dominer?
Former les responsables et les agents à respecter le document, considérer l’écrit comme une garantie et non une menace, est la condition première du passage d’une logique d’instruction à une logique de droits.
6. Enraciner la culture juridique par les critères de nomination et de gestion des responsabilités
La réforme véritable ne se limite pas à corriger les comportements quotidiens, elle est intimement liée au système de valeurs et de critères qui gouverne l’accès aux fonctions publiques, en particulier aux postes de responsabilité. La dérive des instructions orales est indissociable des nominations non fondées sur le mérite ou la compétence, mais sur la loyauté personnelle, l’appartenance politique ou le clientélisme.
Dès lors, une question cruciale se pose : un responsable nommé hors logique de compétence peut-il réellement adhérer à une culture de légalité et de transparence ?
La réponse semble évidente : celui qui a été élevé dans la logique de nomination par loyauté gouvernera par l’oral, fuira la documentation et préférera l’obéissance aveugle à la reddition de comptes fondée sur les textes.
D’où l’importance d’enraciner les principes d’égalité des chances, de mérite, de compétence et de transparence dans les nominations, comme l’exige la Constitution marocaine. C’est là l’une des conditions essentielles pour prémunir l’administration contre l’arbitraire oral et construire l’État de droit, du sommet à la base.
S’ajoute un autre impératif : promouvoir les principes de justice, d’équité, de moralisation de la vie administrative, et de lien entre responsabilité et reddition des comptes, tels qu’énoncés dans le préambule et l’article premier de la Constitution marocaine de 2011, affirmant que le régime constitutionnel repose sur la séparation, l’équilibre et la coopération des pouvoirs, la démocratie participative, la bonne gouvernance et la responsabilité liée à la reddition des comptes.
Ces valeurs ne sont pas de simples slogans moraux : elles constituent un socle juridique devant se traduire dans la pratique quotidienne, depuis la manière de donner des instructions jusqu’au processus de décision, en passant par la sanction de tout abus de pouvoir ou infraction à la loi.
Conclusions générales :
Pour passer d’une pratique autoritaire obscure à une gouvernance transparente et responsable, il convient de :
• Criminaliser les instructions orales dans les matières essentielles, par des dispositions explicites du droit administratif marocain.
• Créer une plateforme nationale électronique pour documenter toutes les instructions administratives émanant de hauts responsables.
• Protéger juridiquement et institutionnellement l’agent qui refuse d’exécuter des ordres non écrits ou contraires à la loi.
• Intégrer la culture de la documentation et de la responsabilité dans la formation initiale et continue des agents.
• Délimiter avec précision temporelle et matérielle le champ d’usage de l’oralité, comme exception ponctuelle et non comme mode de gestion permanent.
Ces mesures sont applicables concrètement ; elles fournissent un cadre clair pour lutter contre la corruption, renforcer l’État de droit et garantir les droits des agents et des citoyens.
Conclusion :
L’écrit n’est pas qu’un outil administratif. C’est un acte éthique et institutionnel, car il engage son auteur et réintroduit l’action dans le cercle de la justice. Et lorsque chaque responsable et agent aura pour devise : « Je n’exécute que ce qui m’a été écrit, dans les limites permises par la loi », alors seulement aurons-nous entamé la construction effective d’un État de droit fondé sur la loi, et non sur l’arbitraire.
——————-
• Extrait de l’ouvrage du Dr Abdellah CHANFAR :
L’administration marocaine et les exigences du développement : étude sociojuridique et analytique, Éditions de la Revue marocaine de l’administration locale et du développement, Rabat, n°19, collection « Œuvres et travaux universitaires », 2000.






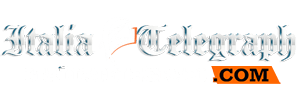

 English
English Español
Español Deutsch
Deutsch Français
Français العربية
العربية