Lecture sans vision et analyse sans compréhension : Comment « Le Monde» traite-t-il les réformes du roi Mohammed VI (3/6)
Par Dr Mohamed Berraou
Expert international en gouvernance, auteur de La bonne gouvernance à la lumière des orientations royales.
Troisième réponse à la série “L’Énigme Mohammed VI” publiée par Le Monde
Une critique enfermée dans son prisme : les réformes vues comme des faux-semblants
Dans son troisième épisode, la série du journal le Monde poursuit sa tentative de décryptage du règne de Mohammed VI. Elle s’attarde ici sur la période post-1999, marquée par un élan réformateur inédit dans le monde arabe. Mais rapidement, l’analyse cède la place à un procès d’intention permanent.
La ligne narrative du journal est claire : ce règne n’aurait été qu’une mise en scène, un jeu d’équilibre entre illusion démocratique et maintien de l’ordre établi. La monarchie y est décrite comme habile stratège d’un « réformisme de façade », dans une mise en accusation qui s’ignore.
Mais une telle grille de lecture réduit le réel à une caricature. Elle passe à côté de l’essentiel : la transformation du Maroc ne s’inscrit pas dans une logique binaire entre ouverture et répression, mais dans un processus historique, complexe, progressif et profondément enraciné dans le contexte national.
Réformes structurelles : ignorées, dévalorisées ou minimisées
Le texte reconnaît du bout des lèvres les grandes réformes menées entre 1999 et 2011 : la Moudawana, l’Instance Équité et Réconciliation, la réforme constitutionnelle. Puis, aussitôt, il les relativise, les minimise, les soupçonne.
Quand une réforme n’est pas parfaite, Le Monde y voit une manipulation. Quand elle est pionnière, il la soupçonne d’opportunisme. Quand elle fonctionne, elle serait… une « vitrine ».
Mais toute réforme – surtout dans une société marquée par la pluralité culturelle, la tradition religieuse et la mémoire coloniale – est forcément progressive, souvent conflictuelle, parfois partielle. Cela ne l’annule pas. Au contraire, c’est sa persistance et sa résilience qui en confirment la profondeur.
Une lecture instrumentale du progrès : quand le développement devient suspect
Le Monde semble irrité par les réussites marocaines. Tanger Med, les autoroutes, le TGV, les énergies renouvelables, la généralisation de l’électricité en milieu rural, la stratégie africaine… sont mentionnés, mais réduits à des outils de séduction pour les partenaires étrangers.
Cette façon de disqualifier le progrès dès qu’il ne cadre pas avec une grille idéologique bien précise est révélatrice : dans l’analyse du journal Le Monde, ce qui fonctionne est suspect, ce qui échoue est symptomatique, ce qui résiste est figé.
Et pourtant, ces avancées ne sont pas cosmétiques : elles ont changé le quotidien de millions de Marocains. Elles traduisent une vision souveraine du développement, cohérente, ancrée dans la réalité nationale, mais connectée aux enjeux globaux.
Le pouvoir royal, toujours perçu comme une “entrave”
Tout au long de l’article, la monarchie est présentée comme l’entrave principale à toute modernisation véritable. Une lecture simpliste qui fait abstraction de l’histoire constitutionnelle du pays, du rôle d’arbitre du roi, de la centralité de la monarchie dans la stabilité régionale.
Le Monde oublie une chose essentielle : Mohammed VI n’est pas un chef de gouvernement, ni un parlementaire. Il est le dépositaire d’une légitimité historique, culturelle et religieuse, garant d’unité nationale et d’équilibre institutionnel.
La Constitution de 2011 a introduit de nombreux mécanismes de responsabilisation gouvernementale. Mais elle n’a jamais prétendu transformer la monarchie en monarchie d’apparat. Ce serait méconnaître le pacte politique marocain, qui conjugue permanence de l’institution royale et réformes progressives.
Une critique au prisme d’un modèle unique : l’oubli de la souveraineté
L’erreur la plus fondamentale de l’article, et de la série dans son ensemble, est de considérer le Maroc à travers un seul modèle de gouvernance : celui de la démocratie parlementaire occidentale.
Or, le Maroc ne calque pas ses institutions sur celles d’un autre. Il invente sa propre trajectoire, entre continuité monarchique, ouverture économique, inclusion territoriale, et stabilisation sociale. Ce n’est pas une faiblesse. C’est une stratégie d’adaptation et de projection.
Conclusion : une analyse à l’encre d’un récit pré-écrit
Le Monde, dans cet épisode, ne cherche pas à comprendre. Il cherche à confirmer. Et pour cela, il alimente une idée préconçue : celle d’un roi réformateur en trompe-l’œil, d’un Maroc figé derrière ses infrastructures, d’un peuple frustré mais impuissant.
Mais ce regard est étranger aux dynamiques réelles du pays. Il ne saisit ni la profondeur du changement institutionnel, ni la légitimité du pouvoir royal, ni la complexité du rapport entre société civile, pouvoir exécutif et autorité monarchique.
En définitive, cet article ne révèle pas une énigme. Il enfouit une réalité : celle d’un Maroc en mouvement, parfois lent, parfois heurté, mais toujours maître de son destin.






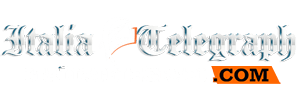

 English
English Español
Español Deutsch
Deutsch Français
Français العربية
العربية