Le romancier Yassine Loghmari rend l’imaginaire plus réel que le réel dans La La supercherie suprême
Un article du grand critique irakien Ali Lafta Saeed
Le roman La supercherie suprême du Grand romancier tunisien Yassine Loghmari, publié par les Éditions Al-Darawish en Bulgarie, entraîne le lecteur et le récepteur dans une course pour saisir les fils de l’intrigue. Le lecteur cherche le plaisir de lire, tandis que le récepteur est amené à réfléchir sur les signes d’une existence confuse et troublée. Ce roman appartient à la littérature de la colère : colère contre tout, colère contre le monde, colère contre les illusions. Entre les personnages et le narrateur, entre le narrateur et l’auteur, entre toutes les instances du récit et son idée maîtresse, s’établissent des relations de tension, de manœuvre et d’alerte.
L’efficacité du titre et les « portes » du roman
Dès le titre et les seuils qui suivent – ces « portes » qui mènent à la cité du roman –, le ton est donné. Le titre La Tromperie de la tromperie sonne comme une alerte, une mise en garde. Il porte un sens multiple : une tromperie apparente, une tromperie qui cache autre chose, une tromperie liée à la colère qui traverse tout le roman. Peut-être s’agit-il d’une tromperie de la réalité elle-même, imposée par la poigne politique ; ou d’une ironie, car tout se répète dans la vie : poigne, coups de feu, marches vers des fins déjà écrites. Peut-être encore d’un titre rhétorique, destiné à attirer l’attention sur ce qui suivra. Le titre devient alors une question implicite : qui trompe qui ? Sommes-nous victimes de la tromperie ou ses complices ?
Dès le départ, il annonce l’ambiguïté de la vérité, la confusion des connaissances, la répétition des mensonges avec de nouveaux masques. Il prévient que le lecteur se trouve face à un texte qui interroge l’évidence et oblige à se méfier des apparences : ici, la tromperie n’est jamais unique, mais multiple et enchevêtrée. Le titre est la grande porte ; les portes secondaires, elles, annoncent ce qui vient : un avertissement en colère, mêlé de peur. L’auteur précise : « Ce roman est une pure fiction. Toute ressemblance avec la réalité est purement fortuite. Mais les événements qui se déroulent à l’école sont réels, je les ai vécus moi-même. J’offre ce roman à mes camarades de classe, devenus aujourd’hui des femmes et des hommes. »
Viennent ensuite des citations d’inspiration politique de Platon, Ahlam Mosteghanemi et Nikos Kazantzakis, sur la tromperie du pouvoir, le prix du règne, la peur érigée en mode de vie. Les clés sont politiques : signe, signifiant et signifié convergent vers le pouvoir trompeur. Ces portes ouvrent la voie à la lecture du roman ; elles servent de clés pour en déchiffrer l’énigme.
La langue et le jeu du récit
La force du roman réside dans sa langue narrative : une langue souple, descriptive, rythmée, qui suit les personnages et traque leurs gestes. Elle oscille entre l’imaginaire tiré du réel et le réel qui devient imaginaire. Le roman adopte le courant de conscience, les hallucinations du narrateur, tout en restant sous le regard d’un narrateur omniscient.
L’ouverture situe la scène un jeudi, dans une cuisine, avec une femme, Ranin. Une ouverture dramatique, visuelle, qui relie le mercredi au jeudi :
« Ce jeudi, Ranin n’avait jamais ressenti une telle fatigue. Elle ne pouvait atteindre ce qu’elle désirait. Elle plongea les morceaux de pommes de terre fendues dans l’huile chaude, le dos courbé, les yeux perdus. La poêle lui parut plus étroite qu’elle ne l’avait imaginé. Elle remua la cuillère en bois lentement. Dans l’évier, à gauche, s’empilaient depuis hier soir des assiettes et des couverts tachés, sortant d’une poubelle pleine de restes pourris. »
Ainsi le récit avance-t-il, mêlant drame, idée, but et interprétation, à travers douze chapitres numérotés, sans titres, comme une suite temporelle fluide.
Le traitement dramatique
Le roman poursuit une visée dramatique : refus politique, oppression sociale, conflits intimes. Le temps devient un acteur essentiel, mais le questionnement philosophique prend le dessus. Les dialogues cherchent à anticiper les réponses :
« Ne t’avais-je pas prévenue de ne pas ouvrir la porte aux étrangers ? »
Il détourna le regard : « Qui d’autre que toi est au courant ? »
« Je vais perdre la tête à cause de toi ».
Les monologues intérieurs, les hallucinations, les ruptures de ton expriment les tiraillements du moi et de ses contradictions. On y retrouve les thèmes du sexe, de la politique, du pouvoir, de la vie elle-même.
En fin de compte, le roman affirme que tout est tromperie, même quand cela semble réel. C’est une œuvre de colère politique, de profondeur existentielle, de critique sociale. La réalité et la fiction s’y entremêlent, la philosophie côtoie la politique et la psychologie, et le lecteur reste suspendu, cherchant à déchiffrer les énigmes d’un monde où la vérité elle-même est une illusion.






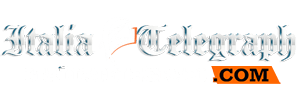
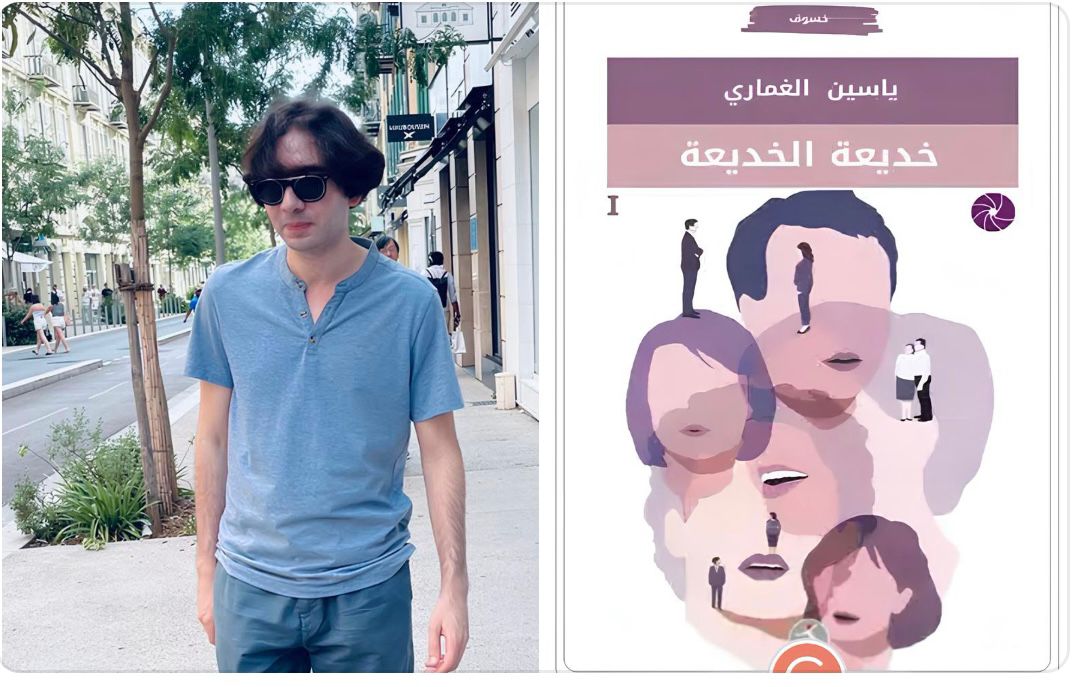
 English
English Español
Español Deutsch
Deutsch Français
Français العربية
العربية