Le régime algérien entre crise de légitimité et impasse des projections extérieures : lecture des déséquilibres dans le voisinage régional
Abdellah Mechnoune
Journaliste en italie
Quand le voisinage géographique devient le théâtre des projections de crise
Nous, Marocains du monde, ressentons une douleur persistante face au comportement du régime algérien envers le Maroc, une douleur mêlée de stupeur et d’indignation devant une hostilité persistante qui dépasse les différends passagers pour revêtir un caractère structurel. Cette attitude traduit une pathologie politique nourrie de l’intérieur d’un système en crise de légitimité, coupé des dynamiques régionales et internationales.
Ce que nous observons aujourd’hui, en termes d’ingérences flagrantes dans les affaires marocaines, ne peut être dissocié d’une logique plus profonde : celle d’un régime qui exporte sa crise intérieure, dans une tentative manifeste de redéfinir son identité politique à travers « l’autre marocain », non pas sur la base d’une altérité constructive, mais par une diabolisation systématique qui substitue au dialogue un antagonisme institutionnalisé.
Le régime algérien, en proie à un blocage structurel de sa représentativité et à une confusion dans ses fonctions, s’arroge des rôles tutélaires dans des dossiers qui excèdent ses capacités éthiques et juridiques, s’appuyant sur un discours désuet hérité de la guerre froide, à une époque où les peuples exigent compétence et efficacité, non slogans et postures. D’où la question cruciale : jusqu’où un régime accusé de répression des libertés et de confiscation de l’espace public peut-il se prévaloir du droit à l’autodétermination au nom d’un groupe séparatiste marginal sans légitimité représentative ?
La contradiction est d’autant plus frappante que ce même régime instrumentalise la question palestinienne contre le Maroc, tout en fermant les yeux sur une normalisation déclarée avec Israël par des pays alliés qu’il ménage sans critique. Une partie de ses médias et de ses appareils de propagande s’emploie ainsi à attribuer tous les échecs internes à une prétendue menace marocaine, diabolisant toute initiative souveraine ou développementale du Royaume, sans jamais s’interroger sur les maux qui rongent sa propre structure : pauvreté, précarité économique, exclusion sociale et absence d’un horizon stratégique.
Crise de légitimité et hypertrophie de la fonction extérieure : quand le régime perd sa boussole interne
On ne peut comprendre le comportement du régime algérien sans revenir à la logique de crise qui mine sa structure depuis des décennies, et qui s’est aggravée avec l’effondrement de la légitimité révolutionnaire et l’érosion de la représentativité populaire. Un État dysfonctionnel dans ses missions politiques, économiques et sociales perd vite son immunité symbolique et glisse vers une dérive identitaire et une confusion dans son rôle historique. Dès lors, l’extérieur devient le prolongement du désordre interne : non pas un espace d’échange, mais un exutoire pour l’angoisse structurelle et un écran servant à projeter les échecs internes sous forme de positions politiques radicalisées.
En ce sens, l’attitude extérieure du régime algérien ne peut être lue comme un choix diplomatique rationnel, mais comme la continuation d’une logique autoritaire qui se sert de « l’ennemi frontalier » pour reproduire une légitimité en déclin, en construisant un ennemi permanent convoqué à chaque montée de la colère populaire ou fragilisation de l’appareil sécuritaire.
La question du Sahara marocain, que le régime algérien réduit à une revendication d’autodétermination, n’est qu’un miroir de cette contradiction : au nom de ce mot d’ordre hérité du XXe siècle, il s’arroge une tutelle sur un groupe séparatiste dénué de toute légitimité démocratique, sans véritable représentativité du peuple sahraoui au sens communautaire. Pourtant, ce dossier continue d’être brandi comme une cause centrale, non par souci des droits humains, mais parce qu’il constitue un écran de fumée idéal pour camoufler la répression interne et justifier le verrouillage institutionnel.
L’hostilité envers le Maroc : entre stratégies de pérennisation et volonté de repositionnement
Le conflit entre le régime algérien et le Royaume du Maroc ne relève pas d’un simple désaccord politique ou différend frontalier classique. Il traduit une dynamique plus profonde : une hostilité structurelle devenue stratégique dans le discours et la pratique de l’appareil étatique algérien.
Le Maroc n’est plus perçu comme un rival géopolitique, mais comme un outil fonctionnel à travers lequel l’État profond en Algérie justifie son propre rôle, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cela s’est manifesté de diverses manières : soutien explicite aux groupes séparatistes, fourniture d’armes, complaisance envers des infiltrations sécuritaires dans les régions du sud marocain, et campagne médiatique systématique destinée à occulter les succès marocains sur les plans diplomatique et développemental.
Cette hostilité ne répond plus à des logiques circonstancielles, mais s’est enracinée comme un élément identitaire du régime. Elle est enseignée, perpétuée et exploitée comme outil de contrôle interne et de positionnement extérieur. Dans ce contexte, il est illusoire de parler de réconciliation sans déconstruire cette matrice idéologique qui fait du Maroc un péril existentiel plutôt qu’un partenaire stratégique.
Les médias officiels algériens : de l’outil d’information à l’organe de légitimation de l’hostilité
Parmi les manifestations les plus visibles de la crise politique en Algérie, figure la transformation du discours médiatique officiel en instrument de propagande visant à justifier l’animosité envers le Maroc. Loin de remplir leur rôle d’éveil citoyen et de questionnement du réel, ces médias se sont mués en dispositifs de dissimulation, alimentant les stéréotypes, diffusant des narratifs fallacieux et amplifiant la rhétorique hostile.
Ils véhiculent des formules toutes faites, diffusées massivement sur toutes les plateformes, reproduisant une image caricaturale du Maroc comme source de menace et facteur d’instabilité. Tandis que toute critique interne du régime est muselée, les attaques contre le Maroc sont libres et encouragées, sans égard au contenu ou au contexte des actions marocaines.
Ce dispositif médiatique contribue à l’ancrage d’une logique conflictuelle, vide le dialogue de son sens, et prive les peuples de la région d’un espace d’écoute mutuelle, d’imagination politique et de construction d’une confiance régionale.
La Palestine comme façade rhétorique : duplicité des discours et éthique de l’hypocrisie
L’usage récurrent de la cause palestinienne dans le discours politique algérien incarne l’une des formes les plus flagrantes de duplicité morale et de manipulation symbolique.
Alors que l’Algérie se présente comme un bastion de la résistance, aucun positionnement ferme n’est observé vis-à-vis des pays qui entretiennent avec elle des alliances stratégiques tout en ayant normalisé publiquement leurs relations avec Israël. L’engagement réel en faveur de la cause palestinienne reste marginal, tant sur le plan diplomatique que sur le terrain. Pire encore, cette cause est souvent brandie comme un levier d’accusation contre le Maroc, qualifié de “traître à la cause”, alors que les mêmes critères ne s’appliquent jamais aux autres.
Cela révèle la fragilité du discours prétendument solidaire, et transforme la question palestinienne en simple outil de propagande instrumentalisé par une autorité en quête de légitimité symbolique.
Conclusion : pour une remise en question structurelle de l’éthique de voisinage et des perspectives de réconciliation maghrébine
L’analyse présentée ici ne vise pas une condamnation conjoncturelle ou une réaction passionnelle, mais appelle à une interrogation profonde de la structure politique algérienne qui se nourrit du conflit et instrumentalise l’hostilité comme écran aux crises internes.
L’expérience montre que les mains tendues du Maroc se heurtent non pas à un rival stratégique, mais à une muraille idéologique dressée par un régime qui tire sa survie du maintien de la fracture.
Dans ce contexte, il devient crucial pour les élites maghrébines et arabes d’engager un travail de déconstruction critique des matrices discursives et idéologiques qui alimentent l’impasse, entravent la réconciliation et sabordent tout projet d’intégration régionale.
Jusqu’où ce comportement hostile peut-il persister sans coûts régionaux majeurs ?
Un régime en déficit de légitimité peut-il prétendre à la tutelle sur les aspirations des peuples ?
Et n’est-il pas temps de déplacer le conflit du champ politique stérile vers un espace culturel et cognitif, où les questions deviennent des outils de refondation et des portes d’entrée vers une nouvelle vision maghrébine, fondée sur la souveraineté mutuelle, l’éthique du respect et une véritable reconnaissance du droit de voisinage ?






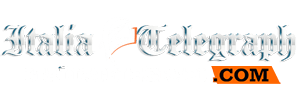

 English
English Español
Español Deutsch
Deutsch Français
Français العربية
العربية