Lecture trompeuse du parcours du prince héritier : de l’essentialisation au dévoiement Ou comment « Le Monde » confond récit psychologique et analyse politique
Par Dr Mohamed Berraou, expert international en gouvernance et auteur du livre La bonne gouvernance à la lumière des orientations royales
Deuxième réponse à l’épisode 2 de “L’Énigme Mohammed VI” paru dans Le Monde (épisode 2/6)
Le scepticisme et l’ambition journalistique fragile
Le deuxième volet de la série que Le Monde consacre au roi Mohammed VI tente de proposer une image intime, centrée sur sa jeunesse et sa relation avec son défunt père, Hassan II. Mais cette narration glisse rapidement vers un ton quasi-narratif, saturé d’anecdotes invérifiables, de jugements psychologisants et de raccourcis historiques. Un tel traitement « familial » du personnage pose deux questions fondamentales : est-il pertinent d’évaluer la légitimité d’un dirigeant à partir de son passé émotionnel ? Et à quel moment l’information cesse-t-elle d’annoncer pour se transformer en outil de formatage de l’opinion ?
Le chef d’État se juge à l’efficacité de son action, pas à un portrait psychologique tronqué
À travers une série d’anecdotes — certaines non vérifiées, d’autres sorties du contexte — Le Monde trace le portrait d’un roi en proie à l’incertitude, manquant de charisme et offrant une image superficielle. Ce parti pris psychologisant éclipse la réalité essentielle : un leader se mesure à sa capacité de réforme, à son aptitude à maintenir l’unité nationale et à guider son pays dans le monde contemporain. Réduire la carrière de Mohammed VI à ses affinités musicales ou à son style de vie constitue une stratégie narrative qui néglige délibérément les axes structurant du pouvoir opérés depuis 1999. Au-delà d’un simple oubli, c’est un choix intentionné visant à teinter le récit d’un biais.
Des failles méthodologiques manifestes
Le texte présente un monarque façonné comme marginal, mal préparé, inapte à gouverner. Or, la réalité montre une formation solide en droit et en sciences politiques, un parcours académique (notamment un stage à la Commission européenne et une thèse de droit), et une montée graduelle dans les responsabilités publiques. Le détachement initial de son père n’est pas symptomatique d’une faiblesse, mais d’un processus éducatif royal balisé par la patience et un apprentissage progressif. De plus, l’absence de vérification des sources, d’analyse critique ou d’enquête indépendante compromet gravement la crédibilité de ce travail journalistique.
Une analyse centrée sur la subjectivité occidentale
Un défaut typique de l’approche occidentale — et en particulier française — envers le Maroc consiste à ne pas percevoir un modèle fondé sur sa spécificité historique. Le Mond eprésente de manière étroite un pouvoir fondé sur le personnage et le psychologique, plutôt que de saisir la fonction stabilisatrice de la monarchie, la place de Rabat dans les transformations régionales ou sa capacité à absorber les mutations internationales. Le narratif s’élève au rang de cliché : fêtes, colères, festivals artistiques… alors qu’il passe sous silence l’arène politique elle-même.
La jeunesse n’a jamais été synonyme d’irresponsabilité
Loin de l’image d’un prince frivole ou immature que tente de dessiner Le Monde, les premières années du règne de Mohammed VI ont été le théâtre de réformes majeures : réforme du Code de la famille (Moudawana), lancement de l’INDH (Initiative nationale pour le développement humain), ouverture sur le continent africain, réformes politiques et institutionnelles. Ces faits, absents des deux premiers épisodes, sont pourtant développés en détails dans les deux premiers chapitres de mon livre (gouvernance politique et développement). Leur absence dans la narration de Le Monde, au profit d’une mise en scène divertissante, ne rend pas justice à un pouvoir conscient de l’équilibre entre ouverture et tradition.
Conclusion : entre illusion d’un éclairage nouveau et réalité déformée
L’épisode 2, annoncé comme une clé permettant de révéler le « mystère Mohammed VI », n’a rien dévoilé. Il a masqué ses propres biais méthodologiques : enquête fondée sur l’intuition, narration partiale, obsession du profil psychologique. Derrière cette focalisation étroite, les deux auteurs reconstituent une personnalité qu’ils réduisent à des traits de superficialité, alors que, depuis un quart de siècle, Mohammed VI incarne un modèle de monarchie stratégique, intelligente et capable de concilier la tradition avec une vision contemporaine.
En vérité, au-delà des clichés malveillants, Mohammed VI demeure un modèle de monarchie marocaine dynamique — fondée sur la gouvernance, la justice sociale et la stabilité.
Enfin, il ne s’agit pas ici de diviniser le roi ni de l’ériger en figure omnipuissante. Mais il est juste d’affirmer que ce type de discours tronqué et déformé, tel qu’il est mis en scène par Le Monde dans le deuxième épisode de sa série, ne répond ni aux standards de rigueur ni à l’exigence d’une analyse responsable.






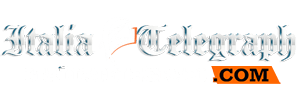

 English
English Español
Español Deutsch
Deutsch Français
Français العربية
العربية