Discours royal et régulation de l’ordre socio-politique marocain : vers une compréhension structurelle de l’autorité symbolique et de la légitimité historique
Dr .Abdallah Chanfar
Il n’est pas possible de comprendre le discours royal au Maroc à travers les outils traditionnels d’analyse politique, qui supposent une compétition directe ou une rotation périodique du pouvoir. Ces approches réduisent une institution extrêmement complexe à un cadre simpliste, ce qui empêche de saisir sa position et son rôle structurel au sein de l’État et de la société.
La monarchie marocaine n’est pas seulement un acteur dans le champ politique ; elle est l’acteur fondateur de ce champ lui-même. Elle garantit l’unité et la continuité de l’action politique et constitue le point de référence qui structure le cadre du sens social et politique dans lequel tous opèrent.
Par conséquent, le discours royal devient l’expression du pouvoir symbolique, selon la définition des juristes constitutionnalistes, c’est-à-dire la capacité à produire du sens et à reproduire les cadres de référence qui permettent aux acteurs de comprendre les limites de ce qui est politiquement, administrativement et socialement possible.
II. La monarchie comme régulateur de l’ordre national
La monarchie marocaine tire sa force et sa spécificité d’une structure historique complexe qui mélange légitimité religieuse, souveraineté politique, symbolique et pratique.
Sa Majesté le Roi, en tant qu’Imam suprême, jouit d’une légitimité religieuse qui le qualifie comme symbole de l’unité nationale et gardien de ses valeurs fondamentales. Parallèlement, son autorité constitutionnelle et politique lui permet de traduire cette référence dans les politiques publiques de l’État.
En ce sens, la monarchie exerce une fonction structurelle de régulation de l’ordre national, en déterminant le rythme général des relations entre les différents champs :
• Champ religieux : maintenir la référence unificatrice de l’école malikite, du credo ash‘arite et du soufisme sunnite, encadrant ainsi l’unité de la pratique et de la croyance religieuse.
• Champ politique : structurer la compétition multipartite selon une logique de stabilité, empêchant qu’elle ne devienne un conflit à somme nulle menaçant la cohérence institutionnelle.
• Champ social et culturel : servir de pierre angulaire de l’identité nationale, en intégrant la diversité ethnique et linguistique dans un horizon national cohérent.
• Champ économique et administratif : agir comme force dirigeante et orientatrice, répondant aux transformations économiques mondiales tout en assurant la continuité de l’État face aux défis internes et externes.
Ainsi, le discours royal se transforme d’un simple événement communicationnel ou discours politique éphémère en un mécanisme de reproduction de l’ordre symbolique et de la légitimité historique sur lesquels repose la structure marocaine.
III. Autorité symbolique et production du sens politique
La monarchie exerce ce que l’on peut appeler une « violence symbolique légitime », remodelant la conscience des acteurs et déterminant ce qui est pensable et impensable dans le champ politique.
Le discours royal ne se limite pas à orienter l’action gouvernementale ou partisane ; il redéfinit les limites mêmes du domaine politique, se présentant comme une volonté stratégique suprême ou une vision fondatrice du sens.
Ce type de pouvoir symbolique ne repose pas sur la contrainte directe, mais sur l’acceptation sociale volontaire de la légitimité historique de la monarchie, selon une logique de « hégémonie par le consentement et l’adhésion ».
La monarchie produit la légitimité comme capacité à représenter le tout, transcendant les contradictions régionales et politiques, consolidant le sentiment partagé d’appartenance, et garantissant sécurité, stabilité, continuité, développement et construction sociale.
IV. La légitimité historique comme mécanisme de continuité
La légitimité monarchique repose sur trois piliers interdépendants :
1. Légitimité religieuse, dérivée de la bay‘a et de la fonction d’Emir des Croyants, conférant au Roi une autorité symbolique suprême dans les domaines religieux et moral.
2. Légitimité historique, issue de la continuité dynastique de la monarchie, faisant d’elle un axe central de l’identité nationale depuis des siècles.
3. Légitimité constitutionnelle et développementale, renforçant le rôle contemporain de la monarchie à travers les réformes politiques et développementales continues.
Ces éléments se combinent pour produire ce que l’on peut appeler une « légitimité composite », donnant au discours royal sa force fondatrice et en faisant un discours unificateur qui dépasse la logique de conflit ou de domination. Lorsque le Roi s’adresse à la nation, il parle à l’ensemble de la communauté nationale, symbole de sa continuité et garant de sa stabilité.
V. De la compétition à la fondation : limites de l’analyse réductionniste
Certaines analyses académiques ou médiatiques présentent le discours royal dans la logique binaire du « vainqueur et perdant » ou comme simple orientation des acteurs politiques.
Ces perspectives négligent la nature structurelle de la monarchie, traitant le discours comme un acte réactif circonstanciel, alors qu’il constitue fondamentalement un acte fondateur de sens, redéfinissant les limites du champ politique lui-même.
C’est ici que réside l’importance de ce que l’on peut appeler la conscience épistémologique du contexte marocain, c’est-à-dire la compréhension de la spécificité du système national et la nécessité de fonder l’analyse sur ce contexte complexe plutôt que d’y imposer des modèles externes.
Toute analyse qui ignore cette compréhension structurelle tombe dans ce que l’on peut qualifier de « handicap socio-cognitif », incapable de reconnaître que le discours royal se mesure selon les standards d’une légitimité symbolique durable et non selon la rotation démocratique traditionnelle du pouvoir.
VI. La monarchie comme acteur modernisateur dans la continuité
L’expérience marocaine montre que la monarchie n’est pas seulement garante de la stabilité, mais également acteur modernisateur, redéfinissant la relation entre l’État et la société dans le cadre d’un projet réformiste graduel.
Les discours royaux successifs témoignent d’une conscience stratégique du besoin de transformation interne au système, c’est-à-dire « changer de l’intérieur », tout en maintenant le cadre de référence qui assure la stabilité et la spécificité de l’État.
Cette approche permet à la monarchie de conduire les réformes politiques et constitutionnelles, telles que la Constitution de 2011, ainsi que des réformes économiques majeures, tout en assurant la continuité de l’ordre symbolique et de l’identité historique.
Conclusion : Le discours royal comme horizon structurant de l’identité politique marocaine
Le discours royal représente un mécanisme socio-politique de production du sens et de légitimité, et non un simple outil d’orientation des politiques publiques. Il reconstruit continuellement le consensus autour de la symbolique de l’État, incarnant un équilibre délicat entre permanence et changement, légitimité et administration, sacré et politique.
Ainsi, la compréhension du discours royal n’est complète que lorsqu’il est placé dans le système d’autorité symbolique qui structure l’action politique marocaine, faisant de la monarchie le centre d’équilibre et la référence unificatrice qui accueille la diversité sans la réduire.
En ce sens, le discours royal devient un espace de renouvellement du contrat symbolique entre l’État et la société, plutôt qu’une occasion de diviser les Marocains en vainqueurs et perdants. Il exprime l’unité de la nation dans sa diversité et la capacité du système marocain à se renouveler de l’intérieur sans perdre son équilibre historique ni son identité civilisationnelle.






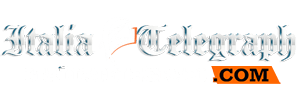

 English
English Español
Español Deutsch
Deutsch Français
Français العربية
العربية